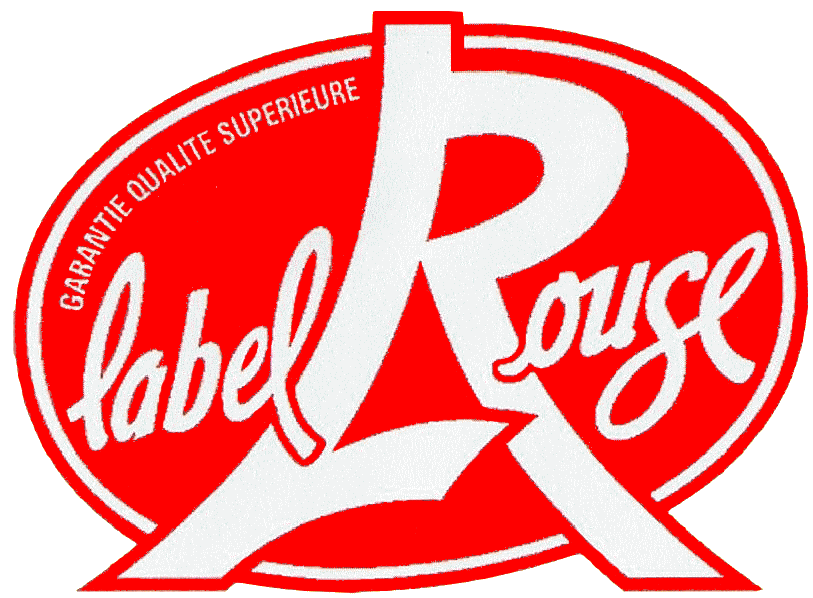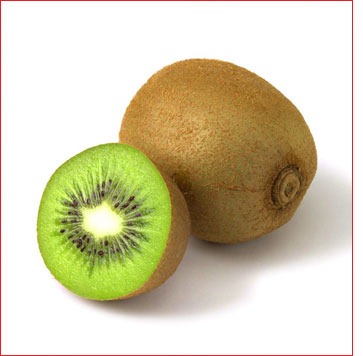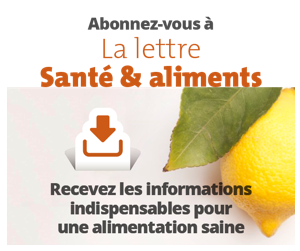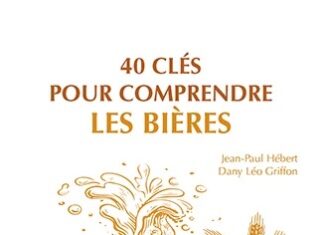Le chlordécone, insecticide utilisé pendant vingt ans aux Antilles, a contaminé les sols et l’eau pour des siècles, et porté gravement atteinte à la santé de la population. Exemple d’un usage aberrant de chimie en agriculture.
Le chlordécone est un pesticide organochloré utilisé massivement en Martinique et en Guadeloupe dans les années 1970-1980 pour lutter contre le charançon, un insecte volant (coléoptère) ravageur des bananeraies. Selon un chercheur de l’Inra, les cultivateurs ont déversé quelques 300 tonnes d’insecticide chlordécone pendant une vingtaine d’années. Or, un seul kilo suffit à empoisonner durablement plusieurs hectares.
La grande toxicité
La diffusion de ce pesticide est d’autant plus aberrante que dès le début des années 1970, la Commission des toxiques (institution officielle) met en garde contre la grande toxicité de ce produit qui s’accumule dans les tissus vivants, dans les sols et l’eau. Au fil des études scientifiques, ce pesticide se révèle avoir des effets délétères sur le système nerveux, la reproduction, le système hormonal et le fonctionnement de certains organes. Les Etats-Unis interdisent le chlordécone en 1976, suite à un accident sanitaire grave (contamination des ouvriers d’une usine de fabrication du pesticide).
Polluant organique persistant
Mais il faut attendre 1990 pour que les pouvoirs publics français reconnaissent enfin les risques sanitaires de ce pesticide organochloré, polluant organique persistant. L’usage en est interdit. Mais le ministère de l’Agriculture continue d’accorder des dérogations jusqu’en 1993. De leur côté, les cultivateurs vont écouler les stocks pendant encore une dizaine d’années. La Commission européenne l’interdit formellement en 2003, presque trente ans après les Etats-Unis !
Cancérigène, dommages neurologiques…
La gestion des pouvoirs publics (français et européens) est fortement critiquée par diverses commissions d’enquête. Car le « bilan chlordécone » est catastrophique. Primo, il s’agit sans conteste d’un polluant très dangereux, aux incidences indéniables sur la santé : effets cancérigènes, dommages neurologiques, perturbateurs endocriniens…. Guadeloupe et Martinique présentent des taux de cancer de la prostate (500 cas par an dans chaque département) parmi les plus élevés au monde (deux fois ceux observés en métropole) et un grand nombre de naissances prématurées.
Les tubercules contaminées
Les dommages sur la nature en Martinique et en Guadeloupe sont considérables. Les rivières, les cultures en aval des bananeraies, l’herbe, le lait des vaches, le poisson, les crustacées… la molécule insecticide « remonte » partout. Nombre d’aliments présentent désormais des teneurs anormales de chlordécone. Paradoxalement, la banane, poussant « en partie aérienne » de la plante, n’est pas touchée. Mais les tubercules qui poussent dans les sols, tels que la patate douce, l’igname, le taro (dachine) très consommées localement, captent les contaminants.
Lire aussi : Chlordécone, un contaminant persistant aux Antilles
Selon certains chercheurs, il faudra près de 700 ans avant que ce polluant se dissipe totalement. Ce désastre écologique a de quoi révolter les citoyens, au premier rang desquels les Français d’outre-mer.
JC Nathan