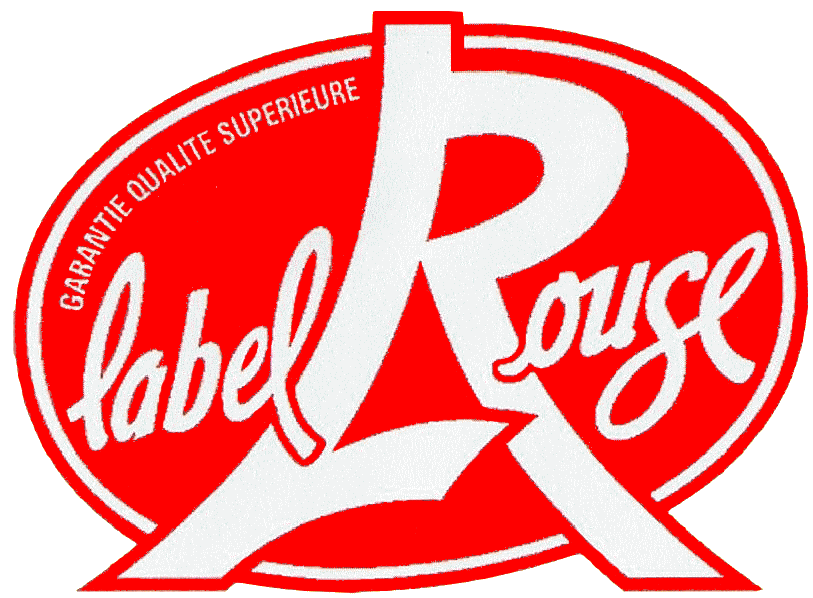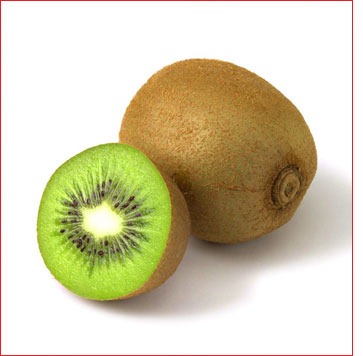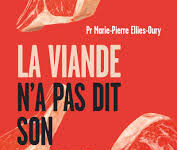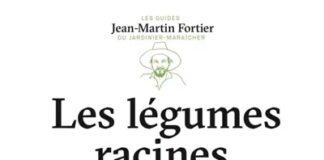Après les OGM (Organismes Génétiquement Modifiés), voici les NTG, les Nouvelles Techniques Génomiques. Des nouveaux produits du génie génomique qui remodèlent une partie des plantes et des futures cultures.
On parle moins des OGM, et de plus en plus des NTG, Nouvelles Techniques Génomiques. Pour comprendre cette nouvelle catégorie du génie génétique, il faut revenir à la définition et à la naissance des OGM dans les années 1990. Par OGM, on désigne des organismes dont le patrimoine génétique a été modifié en supprimant, en introduisant ou en remplaçant de l’ADN (domaine du génie génétique). La technique prédominante a été la transgénèse, ç.à.d l’introduction d’un ou de plusieurs gènes pour modifier les caractéristiques de la plante.
Lire aussi : Nouvelles Techniques Génomique, des plantes en discussion
OGM, 10% des surfaces cultivées
Dans le domaine des plantes, les OGM ont donné naissance à de nombreuses variétés de maïs, de soja, de coton… supposées plus productives, moins vulnérables aux parasites (champignons, bactéties, insectes…). Dans le monde, on estimait en 2019 les cultures OGM à 190 millions d’hectares (environ 10% des surfaces cultivées). En Europe, seuls l’Espagne et le Portugal cultivent un OGM, le maïs MON810, modifié pour être résistant aux insectes ravageurs (on a ajouté un gène provenant d’une bactérie du sol Bacillus thuringiensis qui permet à la plante de produire une molécule insecticide). L’Europe importe néanmoins des OGM pour l’alimentation animale (tourteaux de soja par exemple)
Par ailleurs, des millions d’animaux transgéniques (rats, lapins, chèvres, vaches, moutons, poissons…) sont utilisés en laboratoires à des fins de recherche.
Modifier le génome de manière ciblée
Depuis une quinzaine d’années, sont apparues des New Breeding Techniques (nouvelles techniques de sélection végétale) qu’on requalifie désormais de Nouvelles Techniques Génomiques, NTG (en anglais, NGT, New Genomic Techniques). Ces NTG visent à modifier le génome de manière ciblée ou à moduler l’expression des gènes. Mais elles ne recourent pas à l’ajout de gènes entiers issus d’autres espèces dans l’organisme final. L’une des NTG consiste à modifier la séquence génétique de l’organisme au niveau d’un site précis du génome, en utilisant une paire de ciseaux moléculaires dite système CRISPR-Cas9. On parle de mutagénèse dirigée (modification limitée du génome de la plante). Une autre NTG consiste à modifier l’organisme à partir de gènes issus de la même espèce ou d’espèces compatibles sexuellement. On parle de cisgenèse ou intragenèse.
Lire : Les nouveaux OGM arrivent en Europe
Des ciseaux moléculaires
La technique des ciseaux moléculaires est facilement mise en œuvre et peu coûteuse, et déjà diverses variétés végétales NTG sont commercialisées hors de l’Union européenne (par exemple, des bananes qui ne brunissent pas, cultivées aux Philippines). Avec l’avènement des NTG, des variétés végétales améliorées résistantes au climat, résistantes aux parasites, offrant des rendements plus élevés ou nécessitant moins d’engrais et de pesticides, peuvent voir le jour.
NTG, brevetables ou non
Mais le revers de la médaille se situe du côté des brevets. Faut-il ou non règlementer ces nouveaux objets génétiques ? Faut-il les traiter comme des OGM ou comme des plantes obtenues par des techniques conventionnelles. Les grandes multinationales de l’agro-industrie veulent breveter la plus grande partie des plantes produites grâce à ces techniques et « imposer leur loi ». De son côté, la Commission européenne propose de traiter une partie des plantes NTG comme des plantes traditionnelles, et de les exclure du système des brevets. L’enjeu est d’importance, car les agriculteurs et les semenciers risquent à terme de se retrouver « prisonniers » dans les filets des systèmes de brevets. Des avocats planchent d’ores et déjà pour enrayer un système qui favoriserait à terme un brevetage de l’ensemble du vivant. Le débat au niveau européen s’avère d’ores et déjà tumultueux.
JC Nathan
Sources : Alert’OGM